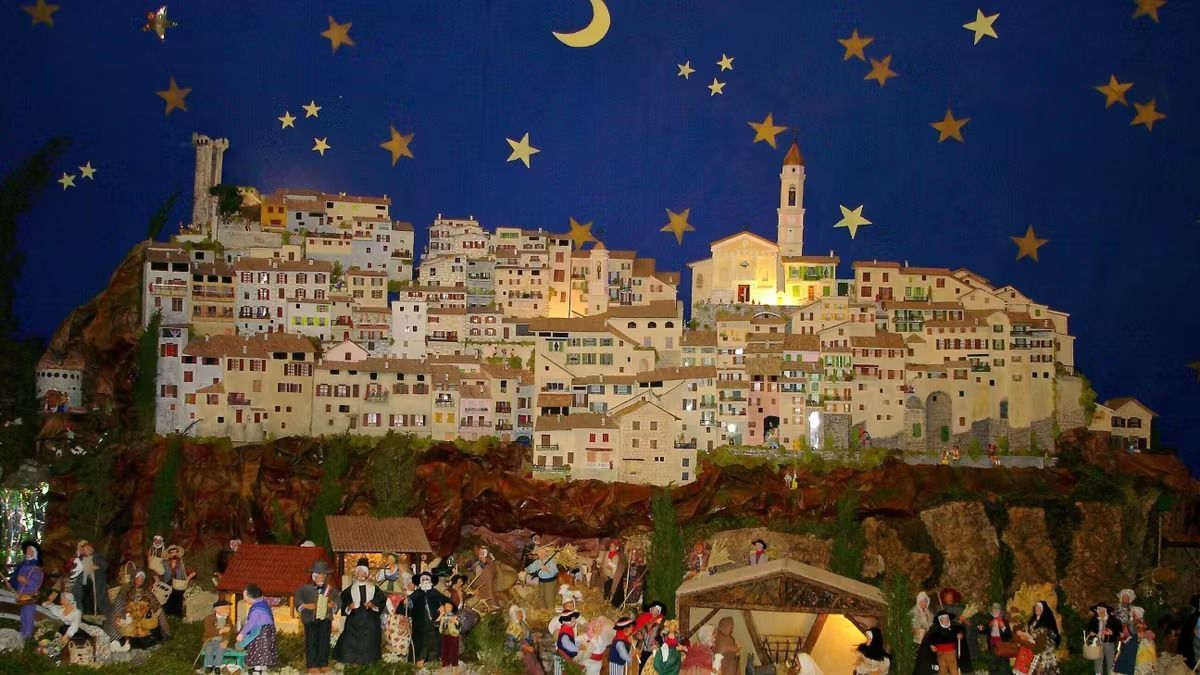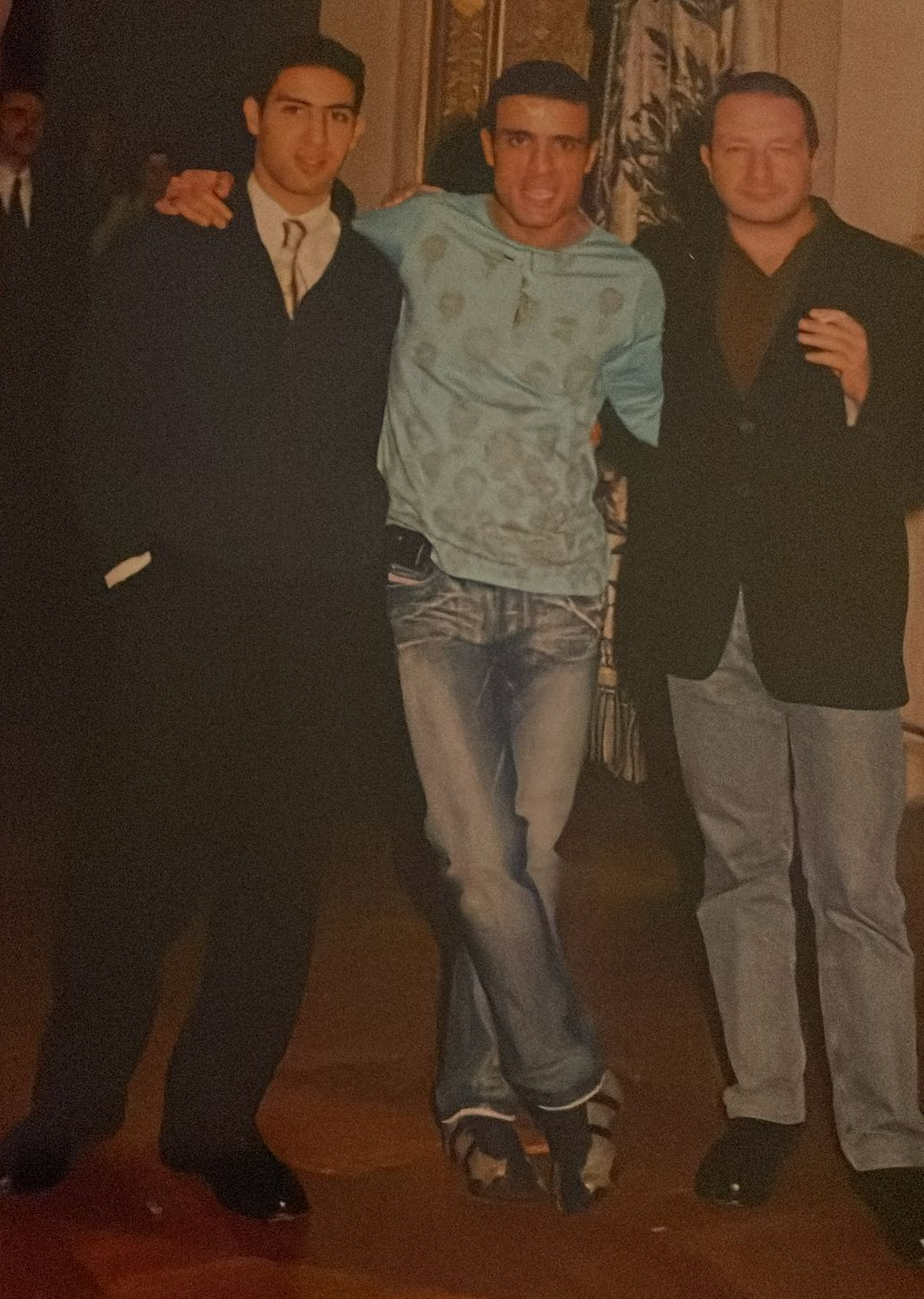BOIS DE BOULOGNE 1852-1855
16° arr., M° Porte-Maillot, Porte-Dauphine ou Porte- d’Auteuil
De la chênaie englobée dans une vaste forêt située sur la route de Rouen, au nord-ouest de Paris, on ne sait pas grand-chose pour les temps anciens, sinon qu’on l’appelait Rouvray parce qu’elle était constituée essentiellement de rouvres, une variété de chênes plus petite que le chêne commun. A l’époque gallo-romaine, elle était ouverte à tous et servait à se chauffer et à se nourrir. C’est avec les Francs mérovingiens, qui y possèdent une maison pour la chasse, qu’apparaissent les premiers droits de chasse réservés au pouvoir. Par une charte de 717, Chilpéric II concède une partie de la forêt de Rouvray à l’abbaye de Saint- Denis.
En 1255, sainte Isabelle, sœur du roi saint Louis (Louis IX), fonde dans la forêt de Rouvray l’abbaye des Pauvres Dames clarisses de Longchamp.
En 1319, pour commémorer un pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, une église dédiée à Notre-Dame de Boulogne est fondée au hameau des Menuls, ancien nom du village de Boulogne.
En 1474, Louis XI donne la charge de la forêt de Rouvray à Olivier Le Daim afin de la remettre en état après les dégâts de la guerre de Cent Ans et de surveiller son exploitation. Deux routes sont alors tracées qui, de Passy, conduisent l’une à Boulogne, l’autre au bac de Neuilly.
François Ier, de retour de captivité après la défaite de Pavie, se fait construire dans la forêt de Rouvray un château destiné à loger la Cour lors des chasses royales. Les travaux commencent en 1527 et cette demeure, inspirée de l’architecture espagnole que le roi avait découverte lors de son exil, recevra le nom de château de Madrid. Dix ans plus tard, le parc était constitué mais le château ne sera achevé que vers 1552, sous Henri II, qui édifie vers 1558 autour du bois un mur de clôture percé de huit portes.
C’est vers cette époque que le nom de Boulogne commence à s’imposer pour désigner la forêt de Rouvray.

En 1572, Charles IX fait construire le pavillon de chasse de La Meutte, futur château de La Muette.
Sous le règne de Henri IV, qui voulait développer en France la culture du vers à soie, 15 000 mûriers sont plantés dans le bois.
C’est Louis XIV qui édicte les premières règles de conservation et de renouvellement des plantations, par la Grande Ordonnance forestière de 1669. Le souverain, qui veut faire du bois un grand domaine pour la chasse royale, fait percer des avenues droites qui se rejoignent en étoiles. Par ailleurs, il autorise l’accès du public en lui faisant ouvrir les huit portes du mur de clôture. Le bois devient dès cette époque, et pour tout le XVIII° siècle, un lieu de promenade très fréquenté des Parisiens le dimanche. Quant à la haute société, elle s’y rend plusieurs fois l’an, en grand équipage, notamment pour la revue militaire dans la plaine des Sablons et pour la traditionnelle promenade à l’abbaye de Longchamp durant la Semaine Sainte.
Au XVIII° siècle, de belles demeures sont élevées en lisière du bois, l’ancien pavillon de chasse de Charles IX est transformé en château de La Muette pour Louis XV et le château de Bagatelle est construit pour le comte d’Artois.
A la Révolution, le bois est presque entièrement dévasté, l’abbaye de Longchamp et le
château de Madrid sont détruits, La Muette est vendue et morcelée et seul Bagatelle échappe à la destruction. En 1815, les Alliés y installent leur campement, causant de si grands dommages qu’une grande partie des arbres disparaît. Il faudra attendre le Second Empire pour que le bois redevienne la brillante promenade qu’il avait été.

Après la révolution de 1848, le bois devient propriété de l’Etat qui le cède en 1852 à la Ville, avec obligation de l’aménager en promenade publique et de l’entretenir.
A cette époque, il existait déjà à Londres des promenades accessibles à tous et Napoléon III, qui
les avait découvertes durant son exil, décida de créer aux portes de Paris la première promenade aménagée pour le public. Voulant éblouir l’Europe entière, il exigea que la promenade soit prête pour l’Exposition universelle de 1855 ; 1 200 hommes et 300 chevaux y travaillèrent sans relâche durant six années.
Hittorff fut nommé en 1852 « architecte du bois » et il s’adjoignit les services du jardinier
paysagiste Louis-Sulpice Varé qui commença de procéder aux aménagements tout en décidant de respecter la topographie des lieux et les arbres existant. Pour répondre aux souhaits de l’empereur, qui voulait une rivière sur le modèle ce celle de Hyde Park à Londres, Varé creusa une large tranchée sur 1,5 kilomètre et comportant deux îles. Malheureusement, ses calculs s’avérèrent mauvais car la dénivellation était telle que les deux extrémités ne pouvaient être en eau simultanément. Hittorff et Varé furent remerciés et Haussmann, qui était devenu préfet de la Seine en 1853, les remplaça par l’ingénieur Jean-Charles Adolphe Alphand qui, assisté de l’horticulteur Jean-Pierre Barillet-Deschamps et de l’architecte Gabriel Davioud, allait mener à bien les travaux de ce parc à l’anglaise tant désiré par Napoléon III.

La rivière fut transformée en deux lacs, le trop-plein du lac Supérieur se déversant en une cascade de 6 mètres de haut dans le lac Inférieur, et les deux lacs, inaugurés en 1854, furent entourés de routes.
A l’exception des allées de la Reine-Marguerite et de Longchamp, qui furent conservées, toutes les autres allées furent modifiées pour être transformées en lignes courbes et sinueuses.
Des pelouses furent créées en bordure des pièces d’eau et de nouvelles portes furent construites, chacune avec sa maison de garde.
A la fin de l’année 1854, le projet était abouti et il ne restait plus qu’à terminer la voirie, soit 58 kilomètres de routes empierrées carrossables, 11 kilomètres d’allées cavalières ensablées et 25 kilomètres de sentiers piétons en sous-bois.
Des acquisitions menées en 1855 avaient agrandi la superficie du bois, sensiblement la même qu’aujourd’hui, et le mur de clôture avait été supprimé.
Alphand compléta le réseau d’eau avec trois rivières alimentées par le lac Inférieur et s’écoulant vers les étangs de la porte de Neuilly, la mare Saint-James et la Grande cascade du carrefour de Longchamp.

De grands arbres et des arbustes, 420 000 environ, furent plantés dans les deux îles du lac Inférieur, aux abords des cours d’eau, des cascades, des principales routes et des entrées du bois, tandis que des massifs de fleurs venaient orner les plus beaux sites.
L’ancien moulin de l’abbaye de Longchamp fut restauré et des bancs, des chalets et des abris furent élevés par Davioud pour les promeneurs. Un hippodrome, celui de Longchamp, fut inauguré en 1857.
Tous ces travaux avaient coûté cher et des concessions furent accordées dès 1854 à des sociétés privées : le Pré-Catelan fut inauguré en 1856 et le jardin d’Acclimatation ouvrit ses portes en 1860.
Le succès fut immédiat et le bois devint, tous les après- midi de la semaine, le lieu des rendez-vous élégants tandis que le dimanche s’y pressaient les bourgeois, les employés et les marchands.
Sous la Commune, de nombreux arbres furent abattus pour consolider les bastions et l’on déboisa pour les besoins militaires mais aussi pour chauffer les Parisiens.
En 1872, on concéda la partie du bois la plus abîmée à la Société des Steeple-Chase d’Auteuil pour y créer un hippodrome réservé aux épreuves d’obstacles, inauguré en 1873. A partir des années 1880, on accorda de nombreuses concessions dévolues au sport mais aussi à l’établissement de restaurants. En 1905, on équipa le bois de candélabres électriques.

Dans un passé récent, la construction du boulevard périphérique a entraîné le creusement d’un souterrain sous le lac Supérieur tandis que le Jardin fleuriste municipal (Serres d’Auteuil) était amputé d’une partie de son terrain.
Aujourd’hui, si le bois de Boulogne n’a pas toujours bonne réputation, surtout la nuit, il offre dans la journée un agréable dépaysement et de nombreux divertissements, avec ses 846 hectares qui conservent, pour l’essentiel, leur tracé de promenade à l’anglaise du Second Empire. Le bois possède de nombreuses espèces et l’on y trouve en quantités à peu près égales chênes, érables, hêtres, charmes, marronniers, tilleuls, pruniers, platanes et robiniers, tous plantés après 1815.